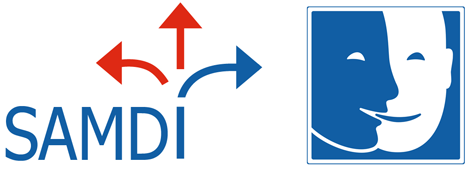Programme scientifique et technique, organisation du projet
Le projet SAMDI est programmé pour une durée de 36 mois. Le programme scientifique se compose de 6 tâches correspondant aux 5 tâches visibles en Figure 1 auxquelles s’ajoute la tâche de coordination de projet.

Figure 1 : Structure du projet
La tâche 1 (T0 – T0+36) est celle de coordination de projet, du début à la fin de celui-ci. Elle est assurée par le LAMIH. Le contenu et les livrables attendus de cette tâche correspondent à la description du rôle du coordinateur.
La tâche 2 (T0 – T0+6) a pour objet d’apporter des connaissances sur les caractéristiques des personnes présentant une déficience intellectuelle, sur leurs compétences de navigation mais également sur leurs comportements de déplacement en se basant sur la littérature scientifique, des entretiens avec les utilisateurs et les professionnels qui travaillent auprès d’eux, des analyses de déplacements (suivis, photovoice, etc.), l’oculométrie (technologie permettant l’identification des informations visuelles utilisées par les personnes) et des expérimentations en environnement réel ou virtuel. C’est le laboratoire PSITEC qui sera responsable de cette tâche, en interaction avec le LAMIH et l’UDAPEI du Nord. Un rapport (L1) est attendu au terme de cette tâche.
La tâche 3 (T0+4 – T0+ 24) a pour objectif de proposer des solutions technologiques adaptées au contexte en favorisant les interactions humain-Machine adaptées aux utilisateurs. Elle se veut itérative et incrémentale, en se situant dans une démarche agile, centrée sur l’utilisateur et ses besoins spécifiques. Cette tâche dépend de la tâche 2. Elle est sous la responsabilité du LAMIH, en relation étroite avec PSITEC et l’UDAPEI du Nord. Il s’agira ici de vérifier la compatibilité des propositions avec la faisabilité d’intégration dans l’outil final, ce sera le rôle d’Urban Labs Technologies. Cette tâche prévoit un livrable (L2) à T0+10 intégrant les propositions d’interactions et à T0+24 (L3) sur l’évaluation d’une des solutions retenue et développée.
La tâche 4 (T0+4 – T0+24) consiste à adopter une approche de co-création afin d’étudier des solutions de mobilité adaptées au public ciblé. Cette tâche est complémentaire à la tâche 3. PSITEC est responsable de la tâche, en forte collaboration avec le LAMIH pour les aspects techniques et les retours, ainsi qu’avec l’UDAPEI du Nord et les associations partenaires qui seront fortement impliquées dans la démarche participative. Cette tâche prévoit un livrable (L4) à T0+10 montrant les avancées de la méthode de co-création et (L5) à T0 + 24 faisant état des évaluations des solutions retenues et prototypées.
La tâche 5 (T0+20 – T0+26) concerne le choix d’itinéraire. Il s’agit ici d’une extension à l’application existante, nommé Jericoapp, qui devra permettre de prendre en compte les spécificités du public visé. En effet, à ce jour Urban Labs Techologies qui est responsable de la tâche n’a pas les connaissances pour développer cette partie du projet. Elle utilisera donc les résultats des tâches 2 et 4 et impliquera également PSITEC et le LAMIH afin d’assurer la compatibilité avec l’interface humain-machine. Le livrable (L6 à T0+26) consiste à fournir une nouvelle version de l’application.
Enfin, la tâche 6 (T0+26 – T0+36) est également portée par Urban Labs Technologies mais elle a l’objectif de fournir des informations du contexte sur une personne ou de faire ressortir d’un groupe les stratégies utilisées. Nous envisageons d’utiliser les données afin de déterminer le profil de l’utilisateur et ainsi mettre en œuvre l’adaptation (tâche 3). Elle est donc à la fois en relation avec les deux laboratoires LAMIH et PSITEC, ainsi qu’avec l’UDAPEI du Nord et les associations partenaires.
Valorisation et promotion du projet
Nous notons 3 axes de Valorisation du projet :
- Le premier axe vise des publications, conférences et journaux scientifiques, aux niveaux national et international, des avancées scientifiques relatives à ce projet.
- Le second axe vise la valorisation auprès du grand public. Le public cible étant en partie acteur du projet, des diffusions sur les réseaux sociaux des démonstrateurs seront envisagées pour une large diffusion.
- Enfin des journées seront organisées à l’aide du pôle PRIMOH et de la MESHS afin de communiquer les résultats de ces recherches.